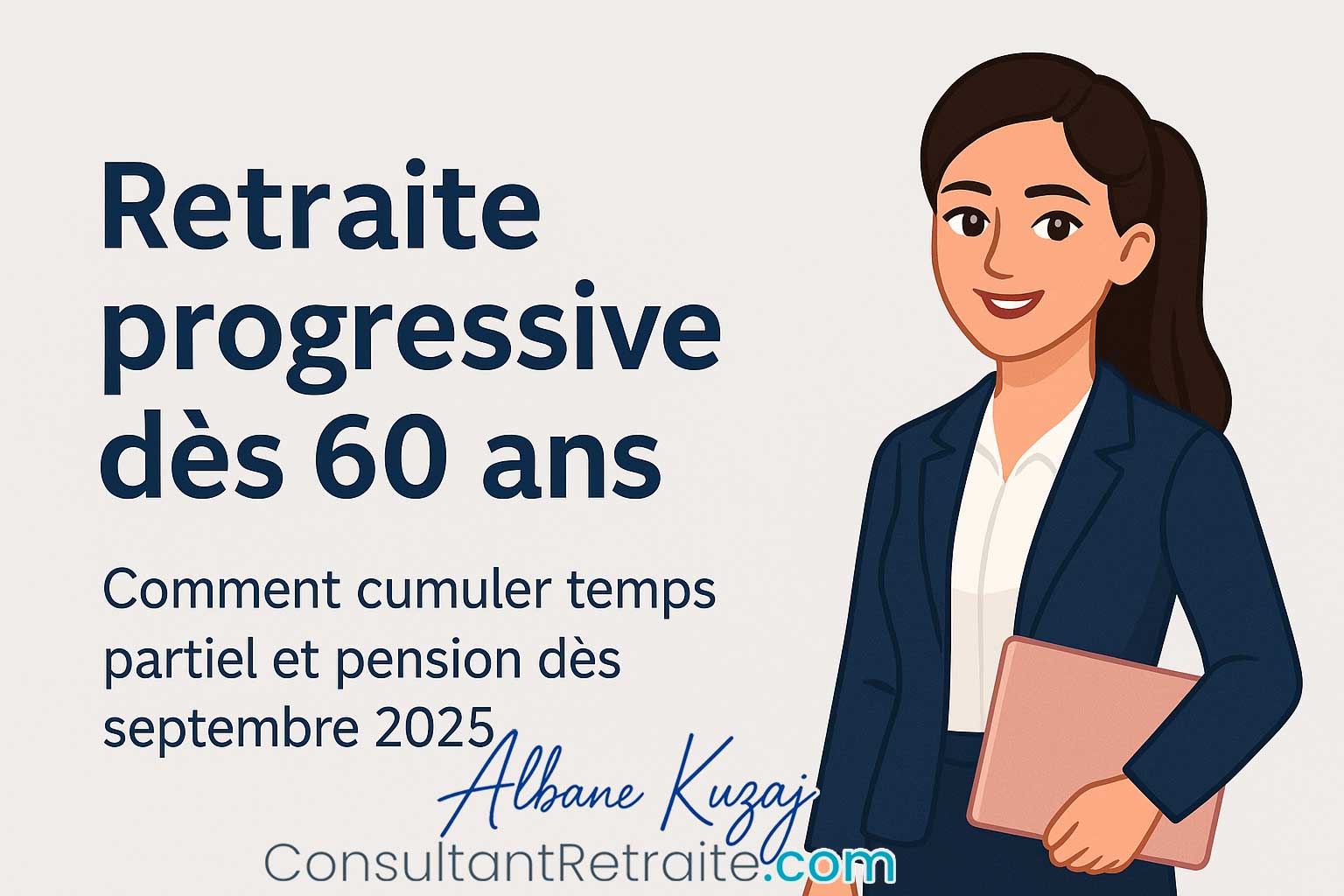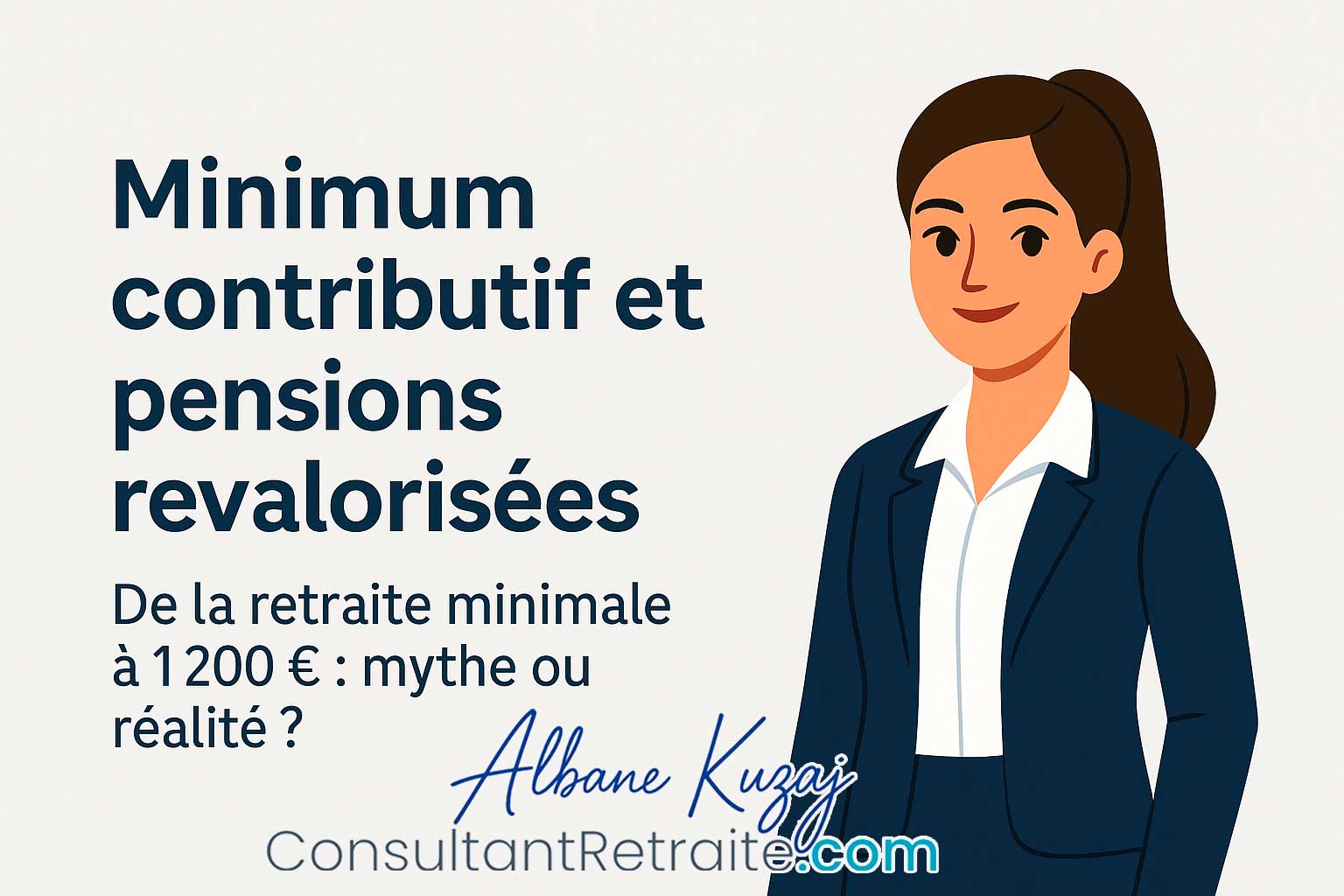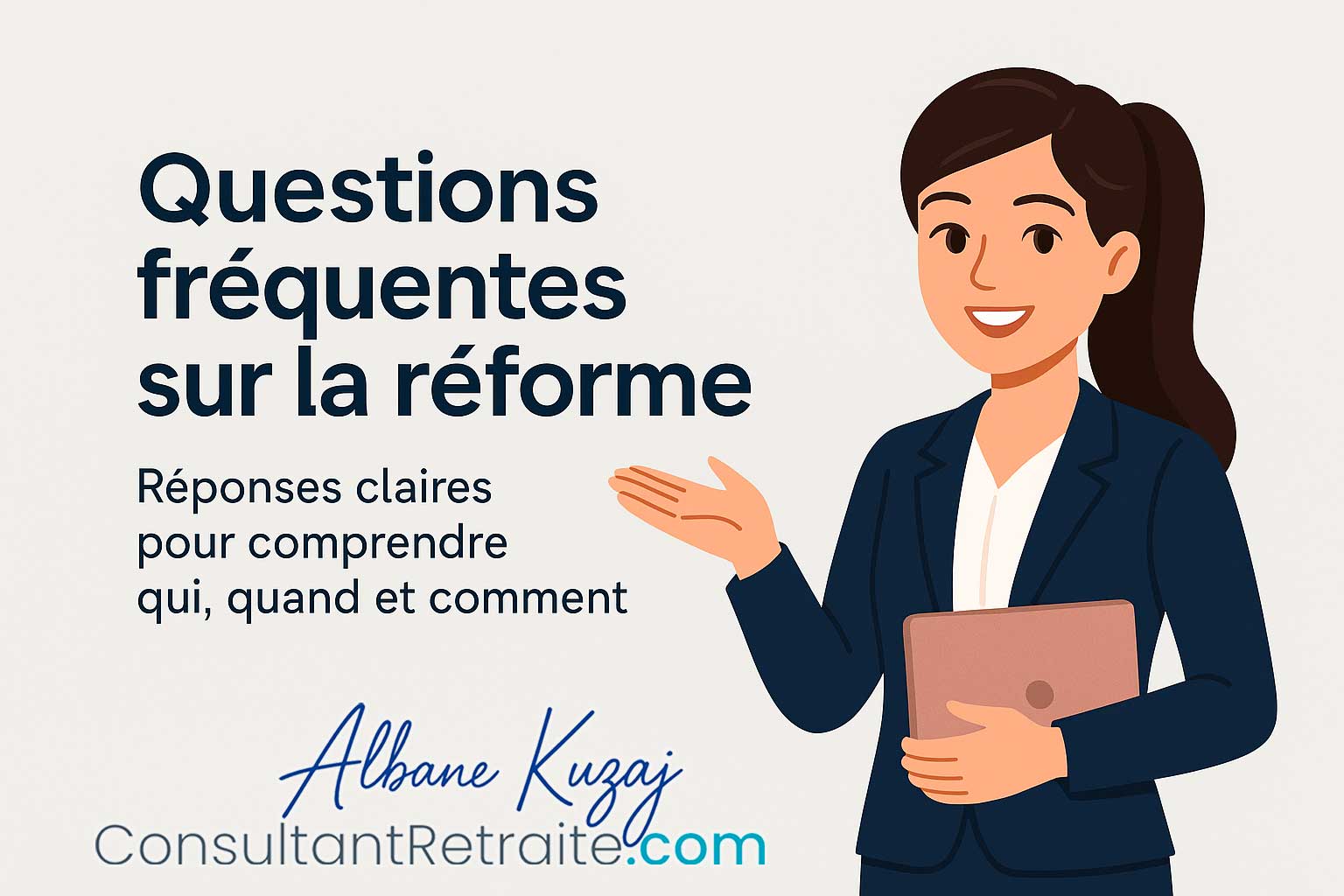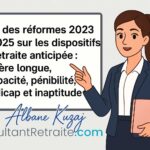Réforme des retraites 2023-2025 : tout comprendre

Article mis à jour le 5 septembre, 2025
📌 Lecture express – Réforme des retraites 2023-2025
En résumé : l’âge légal passe progressivement de 62 à 64 ans (3 mois par génération dès septembre 2023). La durée de cotisation pour le taux plein atteint 43 annuités (172 trimestres).
- Avant sept. 1961 : pas concernés.
- 09/1961-1967 : âge et trimestres augmentent par paliers.
- 1968 et après : 64 ans et 172 trimestres requis.
- Carrières longues : départ possible à 58, 60, 62 ou 63 ans selon l’âge de début d’activité.
- Retraite progressive : accessible à partir de 60 ans dès sept. 2025.
- Droits familiaux et aidants mieux valorisés (surcotes, AVPF, AVA).
- Minimum contributif revalorisé (+75 € env.), mais pas de vraie retraite garantie à 1 200 €.
- Handicap, invalidité : départ anticipé dès 55 ou 62 ans selon le cas.
À retenir : la réforme s’applique depuis le 1er septembre 2023, avec des ajustements jusqu’en 2025. Vérifiez votre âge de départ exact sur Info Retraite ou auprès de l’Assurance retraite.
📖 Vocabulaire à connaître pour comprendre la réforme
- Âge légal : âge minimum pour demander sa retraite (64 ans après la réforme).
- Durée de cotisation : nombre de trimestres à valider pour une pension sans décote (172 = 43 ans).
- Taux plein : retraite calculée sans pénalité, même si le montant reste variable selon la carrière.
- Décote : réduction appliquée si vous partez sans avoir la durée requise et avant 67 ans.
- Surcote : bonus de pension si vous travaillez au-delà de l’âge légal et des trimestres nécessaires.
- Carrière longue : départ anticipé possible pour ceux ayant commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans.
- Retraite progressive : possibilité de travailler à temps partiel dès 60 ans tout en touchant une partie de sa pension.
- Minimum contributif (Mico) : pension minimale garantie aux assurés ayant travaillé toute leur vie avec de bas salaires.
- AVPF : Assurance vieillesse des parents au foyer, attribuant des trimestres aux parents sous conditions de revenus.
- AVA : Assurance vieillesse des aidants, donnant des droits à ceux qui s’occupent d’un proche handicapé.
- C2P : Compte professionnel de prévention, système de points liés à la pénibilité pouvant servir pour partir plus tôt.
- Article 49.3 : procédure constitutionnelle utilisée pour faire adopter la réforme sans vote à l’Assemblée.
Astuce : gardez ces définitions sous la main, elles vous aideront à mieux comprendre les règles et exemples présentés dans l’article.
L’annonce puis la promulgation de la réforme des retraites en avril 2023 ont bouleversé le paysage social français. Elle a soulevé une opposition sans précédent, provoqué des grèves massives et fait l’objet d’un long feuilleton parlementaire marqué par l’activation de l’article 49.3 de la Constitution. Deux ans plus tard, les décrets nécessaires sont publiés et les premières mesures sont entrées en vigueur. La loi ne se limite pas au report de l’âge légal à 64 ans ; elle redessine le dispositif des carrières longues, ouvre de nouveaux droits familiaux, revalorise certaines pensions et crée un fonds dédié à la prévention de l’usure professionnelle.
Cet article se veut un guide complet et actualisé pour comprendre qui est concerné, ce qui change, les dates clés, les générations impactées et les dispositifs transitoires, depuis les premières annonces jusqu’aux dernières évolutions prévues pour 2025. Les termes recherchés sur le Web – tels que « réforme retraite 2025 qui est concerné », « réforme retraite ce qui change », « réforme retraite 65 ans pour qui », « à partir de quelle date de naissance », « combien de trimestres pour la nouvelle réforme retraite », « réforme retraite 49.3 c’est quoi » ou encore « réforme retraite 1963 ou 1964 » – traduisent une grande variété d’interrogations auxquelles nous répondrons point par point. Nous aborderons également des questions plus spécifiques comme la retraite progressive, les carrières longues, les mesures en faveur des femmes, des travailleurs handicapés ou des mères de famille, sans oublier les débats autour de l’abrogation de la réforme et les perspectives d’évolution pour 2025.
Le fil conducteur de cet article s’articule autour des principales mesures de la réforme, mais aussi des étapes politiques qui ont permis ou contesté son adoption. Chaque section est introduite par un titre clair et un résumé illustré. Les réponses sont factuelles, fondées sur des textes de loi et des sources officielles, afin de vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre départ à la retraite.
Qui est concerné par la réforme ?
La première interrogation qui revient constamment est : « Qui est concerné par la réforme des retraites ? ». La réponse dépend de votre année de naissance et de la date à laquelle vous aviez prévu de partir. Le législateur a choisi une mise en œuvre progressive afin de ne pas bouleverser brutalement les plans des personnes proches de la retraite. Les générations sont ainsi réparties en trois catégories :
- Nés avant le 1ᵉʳ septembre 1961 : ces assurés ne sont pas concernés par la réforme. L’âge légal et la durée de cotisation restent ceux en vigueur avant septembre 2023. Autrement dit, ils peuvent partir selon les règles en place auparavant.
- Nés entre le 1ᵉʳ septembre 1961 et le 31 décembre 1967 : ils sont concernés de manière transitoire. Pour eux, l’âge légal et la durée de cotisation augmentent de trois mois par génération. Par exemple, une personne née en 1962 devra attendre 62 ans et 6 mois et justifier 169 trimestres pour bénéficier d’un départ à taux plein, tandis qu’une personne née en 1964 devra attendre 63 ans et justifier 171 trimestres pour le taux plein.
- Nés à partir de 1968 : cette catégorie subit pleinement le report de l’âge légal à 64 ans. Les assurés nés en 1968 ou après devront atteindre 64 ans pour partir avec une retraite à taux plein, en ayant validé 172 trimestres. Le nombre de trimestres requis atteint d’emblée 172 annuités, ce qui correspond à 43 ans de carrière.
Au‑delà de l’âge légal, il faut noter que l’âge d’annulation de la décote reste fixé à 67 ans, quel que soit votre année de naissance. Cela signifie qu’en cas de trimestres manquants, votre pension sera calculée sans décote à partir de 67 ans. Cette mesure demeure inchangée et constitue un garde‑fou pour ceux qui auraient des carrières incomplètes.
Les personnes ayant commencé à travailler très tôt ou ayant connu des situations particulières (invalidité, handicap, carrières pénibles) peuvent toujours bénéficier de départs anticipés, comme expliqué dans les sections suivantes.
Nouveaux âges légaux et nombre de trimestres requis
La mesure phare de la loi du 14 avril 2023 est le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans, à raison de trois mois par génération. Cette évolution s’applique à partir du 1ᵉʳ septembre 2023. Le tableau ci‑dessous récapitule la progression :
| Année de naissance | Âge légal de départ | Nombre de trimestres requis |
|---|---|---|
| 1ᵉʳ septembre – 31 déc. 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 |
| 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 |
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 |
| 1964 | 63 ans | 171 |
| 1965 | 63 ans et 3 mois | 172 |
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 |
| 1968 et après | 64 ans | 172 |
Le principe est simple : chaque génération née après août 1961 voit son âge de départ repoussé de trois mois jusqu’à atteindre l’objectif de 64 ans pour les personnes nées en 1968 et au‑delà. Dans le même temps, la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension à taux plein passe de 42 annuités à 43 annuités. Pour les personnes nées entre 1965 et 1967, cela implique un passage à 172 trimestres dès 2027, au lieu de 2029 prévu initialement. Le rythme d’augmentation est donc plus rapide que celui voté en 2014.
Pourquoi 64 ans ?
Le gouvernement justifie ce report par l’allongement de l’espérance de vie et le déséquilibre croissant entre le nombre de cotisants et celui des retraités. Selon l’exécutif, sans réforme, le régime par répartition accumulerait un déficit atteignant 30 milliards d’euros en 2045. La mesure vise à préserver l’équilibre financier et à sécuriser la retraite des générations futures. Toutefois, les opposants soulignent que d’autres solutions étaient possibles (augmentation des cotisations, taxation des hauts revenus, évolution vers un système en points) et dénoncent une réforme injuste pour ceux ayant commencé à travailler tôt ou occupant des emplois pénibles.
Âge d’annulation de la décote
Un point rassurant pour certains assurés est le maintien de l’âge d’annulation de la décote à 67 ans, quelle que soit l’année de naissance. Cela signifie qu’un salarié qui n’a pas validé tous les trimestres requis pour le taux plein ne subira pas de décote sur sa pension s’il attend 67 ans pour partir à la retraite. En revanche, partir avant 67 ans avec des trimestres manquants entraînera une décote de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres.
Cas particuliers non concernés
Certaines personnes ne sont pas directement concernées par le report :
- Les personnes nées avant le 1ᵉʳ septembre 1961 conservent les règles d’âge et de durée antérieures. Elles peuvent donc toujours partir dès 62 ans si elles justifient du nombre de trimestres requis selon l’ancienne loi.
- Les bénéficiaires de départs anticipés (handicap, inaptitude, pénibilité, carrière longue) pourront continuer à partir avant l’âge légal, parfois avec des conditions revisitées.
Départ anticipé et dispositif carrière longue
Le débat public a beaucoup porté sur les carrières longues et le sort des personnes ayant commencé à travailler jeune. L’objectif annoncé de la réforme était de s’assurer qu’aucun actif ayant commencé sa carrière avant 21 ans ne devrait cotiser plus de 43 annuités. Pour ce faire, le dispositif carrière longue a été remanié :
Quatre paliers d’âge
Avant la réforme, deux paliers existaient (16 ans et 20 ans). Désormais, quatre paliers d’âge permettent un départ anticipé :
- Début d’activité avant 16 ans : départ possible à partir de 58 ans.
- Début d’activité avant 18 ans : départ possible à partir de 60 ans.
- Début d’activité avant 20 ans : départ possible entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance (par exemple, 60 ans et 9 mois pour les natifs de 1965, 61 ans pour ceux de 1966, 61 ans et 3 mois pour ceux de 1967, etc.).
- Début d’activité avant 21 ans : départ possible à partir de 63 ans.
Cette gradation élargit le nombre de personnes éligibles au dispositif. Pour bénéficier d’un départ anticipé, il faut remplir deux conditions :
- Avoir validé un nombre suffisant de trimestres à un âge jeune, généralement cinq trimestres avant la fin de l’année civile de vos 16, 18, 20 ou 21 ans (quatre trimestres suffisent si vous êtes né au dernier trimestre).
- Avoir cotisé la durée requise pour votre génération : la durée cotisée pour obtenir le taux plein reste la référence. Ainsi, un assuré né en 1965 doit justifier 172 trimestres cotisés pour partir en retraite au titre d’une carrière longue.
Les périodes d’assurance réputées cotisées dans une certaine limite pour certaines (congés maternité, trimestres du compte pénibilité, service militaire, etc.) sont prises en compte comme auparavant, avec deux nouveautés : jusqu’à quatre trimestres d’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ou de la nouvelle Assurance vieillesse des aidants (AVA) peuvent être assimilés, et quatre trimestres d’apprentissage achetés pour compléter la période d’apprentissage sont désormais réputés cotisés.
Clause de sauvegarde
Une clause de sauvegarde protège les personnes nées entre le 1ᵉʳ septembre 1961 et le 31 décembre 1963 ayant commencé à travailler avant 20 ans et justifiant déjà de 168 trimestres cotisés au 31 août 2023. Ces assurés pourront partir sans subir le relèvement de l’âge légal, à 60 ans ou 60 ans et quelques mois selon la génération.
Trimestres jeunes et conditions assouplies
Malgré la multiplication des paliers, certains assurés ayant débuté très tôt se voient pénalisés. Par exemple, une personne née en 1965 ayant commencé à travailler à 18 ans et ayant cotisé 172 trimestres en 2025 ne pourra partir qu’à 60 ans et 9 mois. De plus, la règle générale exigeant cinq trimestres validés avant la fin de l’année civile de ses 16, 18, 20 ou 21 ans reste en vigueur. Cela pénalise ceux dont les premiers jobs n’ont pas généré suffisamment de trimestres cotisés (apprentis, jeunes en TUC). Malgré l’annonce officielle selon laquelle aucun actif ayant commencé avant 21 ans ne devra cotiser plus de 43 annuités, de nombreux cas individuels montrent que cette promesse n’est pas garantie.
Retraite progressive : un dispositif élargi
La retraite progressive est un dispositif qui permet de réduire son temps de travail tout en percevant une partie de sa pension. Elle constitue une transition douce entre activité et retraite définitive, très appréciée des salariés souhaitant lever le pied sans perdre totalement de revenu. La réforme de 2023 et les décrets de 2025 ont considérablement élargi ce dispositif.
Âge abaissé à 60 ans en 2025
Avant la réforme, la retraite progressive était accessible 2 ans avant l’âge légal de la retraite soit entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance. Les nouveaux textes fixent désormais l’âge d’accès à 60 ans pour tous, quelle que soit l’année de naissance, pour les retraites progressives prenant effet à partir du 1ᵉʳ septembre 2025. Cette mesure est confirmée par deux décrets publiés le 23 juillet 2025 et s’applique aux salariés du secteur privé ainsi qu’aux agents de la fonction publique.
Pour les retraites progressives ayant pris effet avant le 1ᵉʳ septembre 2025, l’âge demeure compris entre 60 et 62 ans selon la génération, conformément au tableau prévu par l’Assurance retraite : 60 ans et 6 mois pour les natifs de 1962, 61 ans pour ceux de 1964, 61 ans et 6 mois pour ceux de 1966 et 62 ans pour les personnes nées en 1968.
Conditions d’accès
Pour bénéficier d’une retraite progressive, plusieurs conditions doivent être réunies :
- Avoir l’âge requis (60 ans à partir de septembre 2025 ou l’âge indiqué dans le tableau pour les retraites progressives antérieures).
- Avoir validé au moins 150 trimestres (37,5 années) dans tous les régimes de base confondus.
- Exercer une activité réduite ou à temps partiel, comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail.
- Obtenir l’accord de son employeur pour travailler à temps partiel ; en cas de silence pendant deux mois, l’accord est réputé acquis.
Le revenu de pension est calculé au prorata du temps de travail. Par exemple, un salarié travaillant à 60 % de son temps perçoit 40 % de sa retraite. Le dispositif est accessible aux travailleurs salariés, aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants (sous certaines conditions) et aux professions libérales. Les cotisations continuent d’être versées, de sorte que la pension définitive est recalculée à l’issue de la retraite progressive.
Refus de l’employeur et négociation
La réforme encadre le refus de l’employeur : celui‑ci doit désormais être motivé. Pour les agents de la fonction publique territoriale, la possibilité d’obtenir une retraite progressive dès 60 ans à partir de 2025 a été confirmée par un accord interprofessionnel entre le Medef, la CFDT et la CFTC en 2024.
Avantages
La retraite progressive offre plusieurs avantages :
- Souplesse d’aménagement : elle permet d’adapter la fin de carrière aux contraintes personnelles, de conserver un pied dans l’entreprise et de continuer à cotiser.
- Montant final plus élevé : en continuant de travailler, l’assuré génère des droits supplémentaires. S’il choisit de cotiser sur la base d’un temps plein malgré un temps partiel, il peut maintenir le niveau de sa pension.
- Transition douce : psychologiquement, la sortie progressive de la vie active est plus facile à vivre qu’un arrêt brutal.
Droits familiaux, équité et nouveaux avantages pour les femmes
L’une des critiques majeures du système français concerne les inégalités de pension entre hommes et femmes. Les carrières hachées, les congés maternité, le temps partiel et le travail non rémunéré à domicile entraînent souvent des pensions plus faibles pour les femmes. La réforme inclut plusieurs mesures destinées à mieux valoriser ces périodes et à favoriser l’égalité.
Surcote anticipée pour les mères de famille
Les mères de famille ayant rempli la durée d’assurance requise avant d’atteindre le nouvel âge légal bénéficieront d’une surcote anticipée à partir de 63 ans. Cette surcote augmente la pension de 1,25 % par trimestre supplémentaire travaillé au‑delà de l’âge légal, dans la limite de 20 trimestres. La mesure permet de compenser en partie l’impact des interruptions de carrière liées à la maternité et aux congés parentaux.
Valorisation des congés parentaux
Les trimestres d’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) seront désormais comptabilisés dans l’éligibilité aux carrières longues (dans la limite de quatre trimestres) et dans le calcul de la retraite minimale majorée (dans la limite de 24 trimestres). Cela signifie qu’un parent ayant arrêté de travailler pour élever des enfants pourra utiliser ces trimestres pour bénéficier d’un départ anticipé ou d’un meilleur calcul de pension.
Assurance vieillesse des aidants (AVA)
La réforme crée une Assurance vieillesse des aidants (AVA), qui ouvre des droits à la retraite aux parents d’enfants handicapés présentant un taux d’incapacité de 50 % à 80 %, ainsi qu’aux proches aidants de personnes en situation de handicap n’habitant pas avec la personne aidée. Ces périodes de vie consacrées à l’aide d’un proche sont désormais reconnues dans le calcul des droits à la retraite.
Pension pour les enfants orphelins
Une pension pour enfants orphelins est mise en place. Les enfants ayant perdu leurs parents percevront une pension jusqu’à 21 ans, sans limite d’âge pour les orphelins en situation de handicap. Cette mesure vise à protéger les jeunes adultes fragilisés par la perte de leurs parents.
Majoration pour les professions libérales et avocats
La majoration de 10 % de pension pour enfant dès le troisième enfant est étendue aux professions libérales et aux avocats. De plus, le taux de surcote au régime de base passe à 5 % par an contre 3 % auparavant. Les régimes de prestations complémentaires vieillesse des professionnels de santé exerçant en libéral sont désormais ouverts à Mayotte, ce qui améliore la couverture dans ce territoire d’outre‑mer.
Ces mesures, bien que limitées, constituent des avancées concrètes en faveur des femmes et des familles, en reconnaissant les périodes de travail non rémunéré et de soin comme des périodes créatrices de droits.
Revalorisation des pensions minimales et minimum contributif
L’un des arguments du gouvernement était l’instauration d’une « retraite minimale à 1 200 € » pour ceux qui ont travaillé toute leur vie au Smic à temps plein. Cette promesse a suscité beaucoup d’espoir puis de déception. En réalité, il s’agit d’une revalorisation du minimum contributif (Mico) et d’une majoration exceptionnelle pour les retraités déjà en pension, qui ne permettent pas à tous d’atteindre 1 200 €.
Augmentation du minimum contributif (Mico)
Le minimum contributif est la pension minimale de base versée aux personnes ayant cotisé sur de faibles salaires mais ayant validé la durée nécessaire pour le taux plein. À partir du 1ᵉʳ septembre 2023, la majoration au titre de la durée d’assurance passe de 684 € à 709 €, soit 25 € d’augmentation. La majoration au titre de la durée cotisée passe de 747 € à 847 €, soit 100 € de plus. Cependant, ces deux majorations ne s’additionnent pas ; on applique la plus élevée. Pour une carrière complète au Smic, l’augmentation se traduit par environ 75 € bruts supplémentaires. Le minimum contributif évoluera comme le Smic chaque 1ᵉʳ janvier, mais une fois attribué, il progressera selon les règles de revalorisation des retraites.
Jusqu’à 24 trimestres d’AVPF ou d’AVA peuvent désormais être réputés cotisés pour le seul calcul du minimum majoré. Cette mesure bénéficie principalement aux parents au foyer et aux aidants.
Majoration exceptionnelle pour les retraités actuels
Pour les retraités déjà en pension avant septembre 2023, une majoration exceptionnelle (Majex) est accordée. Elle représente 100 € bruts mensuels au prorata des trimestres cotisés, sous réserve de remplir plusieurs conditions : avoir obtenu sa retraite au taux plein, avoir cotisé au moins 120 trimestres, ne pas percevoir de retraite de base supérieure à 847 € (majoration incluse) et avoir un montant total de retraites obligatoires inférieur au plafond en vigueur (1352 € en 2023). Cette revalorisation est appliquée progressivement entre septembre 2023 et septembre 2024.
Pourquoi la promesse des 1 200 € est‑elle trompeuse ?
Le gouvernement a mis en avant le chiffre de 1 200 € pour une carrière complète au Smic. En réalité, ce montant inclut la pension complémentaire Agirc‑Arrco. L’Agirc‑Arrco estime qu’un salarié ayant travaillé toute sa vie au Smic percevrait environ 255 € de complémentaire. Donc, le total atteint environ 1 100 € bruts, non 1 200 €. Une partie de cette somme est revalorisée, mais le résultat final dépend du nombre de trimestres cotisés et de la carrière exacte. Autrement dit, parler d’une retraite minimale à 1 200 € est inexact.
Travailleurs handicapés, invalidité et inaptitude : que change la réforme ?
La réforme ne se limite pas aux salariés du régime général. Elle modifie également les conditions de départ anticipé pour les travailleurs handicapés, les personnes en invalidité et celles reconnues inaptes.
Travailleurs en situation de handicap
Les personnes disposant d’une carte d’invalidité ou justifiant d’un taux d’incapacité permanent peuvent continuer à partir à la retraite de manière anticipée. Pour un départ à partir de 55 ans, la réforme supprime la condition d’avoir validé une durée minimale en plus de la durée cotisée. La procédure de reconnaissance des périodes de handicap est aussi assouplie : les commissions peuvent désormais valider rétroactivement des périodes de handicap dès un taux d’incapacité de 50 % (contre 80 % auparavant).
Inaptitude ou invalidité
La loi crée un départ anticipé à 62 ans en cas d’inaptitude ou d’invalidité (catégorie 2). Cela permet aux personnes dont l’état de santé ne permet plus de poursuivre une activité de partir deux ans avant l’âge légal, sans décote. Cette mesure répond à une revendication des associations de personnes malades ou handicapées, qui dénonçaient la difficulté d’atteindre 64 ans en raison de pathologies invalidantes.
Incapacité permanente et pénibilité
Les âges de départ anticipé pour incapacité permanente (au moins 20 % de handicap) sont maintenus. Les règles du Compte professionnel de prévention (C2P) sont renforcées : le plafond de points est supprimé, l’acquisition de points est facilitée (baisse des seuils pour le travail de nuit et les horaires alternants), et un congé de reconversion est créé pour utiliser les points accumulés. Les trimestres de majoration d’assurance vieillesse acquis via le C2P sont désormais pris en compte dans le calcul de la pension. Enfin, un fonds d’1 milliard d’euros est créé pour financer la prévention de l’usure professionnelle.
Régimes spéciaux et intégration au régime général
La réforme des retraites met fin à plusieurs régimes spéciaux pour les nouveaux entrants, afin de rapprocher les règles du secteur public de celles du secteur privé et de renforcer la lisibilité du système.
Régimes concernés
À partir du 1ᵉʳ septembre 2023, les nouveaux agents de la RATP, de la Banque de France, des industries électriques et gazières (IEG) (EDF, GDF, etc.), les clercs de notaire et les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) seront affiliés au régime général. Les salariés déjà en poste avant cette date conservent leurs droits acquis. Les pensions des régimes spéciaux continueront donc à coexister pendant plusieurs décennies, mais aucun nouveau cotisant ne viendra alimenter ces systèmes fermés.
Fonction publique
La fonction publique (État, territoriale, hospitalière) reste soumise à des règles spécifiques, notamment en matière d’âge de départ et de calcul des pensions (basés sur les six derniers mois pour les titulaires). Toutefois, les fonctionnaires sont concernés par le report de l’âge légal et la durée de cotisation, à quelques exceptions près. Par exemple, certaines catégories actives (policiers, pompiers, personnels pénitentiaires) conservent un âge de départ plus précoce en raison de la pénibilité de leurs missions. Ces catégories verront tout de même leur âge repoussé de deux ans (de 52 à 54 ans ou de 57 à 59 ans selon les cas) pour tenir compte de la cohérence avec les nouveaux seuils.
Prévention de l’usure professionnelle et Compte professionnel de prévention
La réforme consacre un volet important à la prévention de l’usure professionnelle, c’est‑à‑dire aux mesures visant à éviter que la pénibilité n’entraîne des départs anticipés pour cause de maladie ou de handicap.
Fonds dédié et identification des métiers difficiles
Un fonds doté d’un milliard d’euros sur le quinquennat est créé pour financer la prévention de l’usure professionnelle. Les partenaires sociaux sont chargés d’identifier les métiers difficiles, de définir les actions de formation et de reconversion et d’aider les entreprises à mettre en place des mesures de prévention (équipements ergonomiques, amélioration des conditions de travail, etc.).
Renforcement du Compte professionnel de prévention (C2P)
Le Compte professionnel de prévention permet d’acquérir des points lorsque l’on est exposé à des facteurs de pénibilité (travail de nuit, travail en équipes alternantes, vibrations, etc.). La réforme apporte plusieurs améliorations :
- Suppression du plafond de 100 points.
- Baisse du seuil d’acquisition : par exemple, il faut désormais 100 nuits au lieu de 120 pour cumuler des points liés au travail de nuit, et 30 nuits au lieu de 50 pour les équipes alternantes.
- Création d’un congé de reconversion comme nouvelle utilisation des points.
- Meilleure prise en compte de la poly‑exposition : le nombre de points est désormais proportionnel au nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé.
- Inclusion des points du C2P dans le calcul de la pension à taux plein.
Ces mesures visent à rendre le C2P plus efficace et plus simple à utiliser. La logique est de permettre aux salariés exposés à des risques de diminuer leur pénibilité en utilisant leurs points pour financer des formations, des aménagements de poste ou un départ anticipé.
Débats politiques, article 49.3 et adoption de la réforme
La réforme des retraites de 2023 a été adoptée au terme d’une bataille parlementaire inédite, marquée par un recours massif aux procédures constitutionnelles pour contourner l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Le choix d’un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) a offert au gouvernement deux atouts : l’utilisation de l’article 47‑1 (qui fixe des délais contraints d’examen et permet au texte d’être transmis au Sénat sans vote) et la possibilité d’utiliser plusieurs 49.3 « gratuits », c’est‑à‑dire sans limitation sur les lois de finances.
Le recours au 47‑1 et au 49.3
Au Parlement, l’exécutif a utilisé tous les leviers disponibles : après des débats houleux, l’article 7 (recul de l’âge légal) n’a pas été voté dans les délais, si bien que le texte a été transmis au Sénat en vertu de l’article 47‑1 de la Constitution. Au Sénat, l’article 38 du règlement a été utilisé pour écourter les explications de vote et accélérer l’adoption du report de l’âge à 64 ans. Enfin, lors du retour du texte à l’Assemblée, le gouvernement a décidé d’engager sa responsabilité via l’article 49.3, actant qu’il ne disposait pas d’une majorité pour faire adopter le texte. L’article 49.3 permet au Premier ministre de faire adopter un projet de loi sans vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et adoptée. Cela a été le cas le 16 mars 2023, la centième utilisation du 49.3 sous la Ve République. La motion de censure déposée par le groupe LIOT n’a été repoussée que de 9 voix, révélant l’isolement du gouvernement.
Une contestation sociale massive
La réforme des retraites a donné lieu à des manifestations d’une ampleur exceptionnelle, rassemblant de 1,1 à 2,8 millions de personnes lors des journées du 19 et du 31 janvier 2023. Un mouvement intersyndical uni (CFDT, CGT, FO, Unsa, Solidaires, FSU, etc.) a mené plusieurs journées de grève et de mobilisation. De nombreux sondages ont montré que 65 % des Français étaient opposés au report de l’âge de départ à 64 ans, et la contestation s’est poursuivie bien au‑delà de la promulgation de la loi.
L’article 49.3 expliqué
Beaucoup de citoyens se demandent « Réforme retraite 49.3 : c’est quoi ? ». L’article 49, alinéa 3, de la Constitution française permet au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale. Dans ce cas, le projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est votée à la majorité des membres de l’Assemblée. Depuis 2008, son utilisation est limitée à une fois par session parlementaire, sauf pour les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale où elle est illimitée. Dans le cas de la réforme des retraites, le gouvernement a utilisé cet outil car il ne disposait pas d’une majorité claire et souhaitait éviter un vote qui aurait pu échouer.
Rôle du Conseil constitutionnel
Après l’adoption via le 49.3, la loi a été saisie par les parlementaires. Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte le 14 avril 2023, notamment le report de l’âge légal de 62 à 64 ans, et a censuré des dispositions annexes jugées étrangères au budget de la Sécurité sociale. Il a également rejeté une première proposition de référendum d’initiative partagée (RIP) visant à interdire un âge légal de départ supérieur à 62 ans. La loi a été promulguée le lendemain et publiée au Journal officiel le 15 avril 2023.
Les tentatives d’abrogation et l’avenir de la réforme
L’adoption mouvementée de la réforme n’a pas mis fin au débat. Des tentatives d’abrogation ont vu le jour, illustrant la persistance d’une contestation politique et sociale.
La résolution du 5 juin 2025
Le 5 juin 2025, à l’initiative du groupe communiste (GDR), l’Assemblée nationale a adopté une résolution appelant à l’abrogation de la réforme des retraites. Ce texte, voté à 198 voix contre 35, dénonce le recul à 64 ans et l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation. C’est la première fois que l’Assemblée se prononçait sur la réforme, adoptée deux ans plus tôt via le 49.3. Pour la gauche et le Rassemblement national, ce vote symbolique visait à dénoncer une réforme imposée sans vote.
Cependant, cette résolution n’a aucun effet juridique : elle n’oblige ni le gouvernement ni le Parlement à légiférer. Elle témoigne néanmoins d’une volonté de maintenir la pression et de raviver la contestation, notamment à la veille d’un « conclave » mené par François Bayrou avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre a exclu tout retour à 62 ans et imposé une trajectoire budgétaire rigide, limitant ainsi la possibilité d’un compromis.
Perspectives pour 2025 et après
Les discussions ouvertes en 2024 et 2025 portent sur des ajustements plutôt qu’une abrogation totale. Parmi les pistes évoquées :
- Retraite progressive à 60 ans (déjà actée, en vigueur à compter du 1ᵉʳ septembre 2025).
- Nouvelles mesures de pénibilité et élargissement du C2P.
- Réflexion sur un régime universel combinant répartition et capitalisation. Certains experts, notamment à gauche, plaident pour une réforme plus ambitieuse qui rétablirait l’âge légal à 62 ans tout en diversifiant les sources de financement. D’autres défendent un système mixte qui permettrait aux personnes modestes de bénéficier des fruits de l’épargne.
Le débat reste ouvert et dépendra du rapport de force politique après les élections de 2027. En attendant, la réforme de 2023 demeure en vigueur, avec des ajustements techniques prévus jusqu’en 2025.
Foire aux questions (FAQ)
1. À partir de quelle date la réforme s’applique-t‑elle ?
La réforme s’applique à partir du 1ᵉʳ septembre 2023 pour le report de l’âge légal et l’augmentation de la durée de cotisation. Toutefois, certaines mesures (retraite progressive dès 60 ans) n’entreront en vigueur que le 1ᵉʳ septembre 2025. Les départs anticipés pour carrières longues ou handicap peuvent être soumis à des dispositions transitoires.
2. Quelles générations sont concernées ?
Les personnes nées avant le 1ᵉʳ septembre 1961 ne sont pas concernées. Celles nées entre septembre 1961 et 1967 voient leur âge légal augmenter progressivement de trois mois par génération. Celles nées à partir de 1968 devront atteindre 64 ans pour un départ à taux plein.
3. Quelle est la durée de cotisation requise ?
La durée pour bénéficier du taux plein est désormais de 172 trimestres (43 annuités) pour les générations à partir de 1968. Les personnes nées avant 1965 peuvent être soumises à un nombre légèrement inférieur (entre 168 et 171 trimestres) pendant la phase transitoire.
4. Qu’est‑ce que l’article 49.3 ?
L’article 49, alinéa 3, de la Constitution permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote, en engageant sa responsabilité. Le texte est adopté sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures est votée à la majorité absolue des députés. Cet outil a été utilisé pour la réforme des retraites car le gouvernement ne disposait pas d’une majorité claire.
5. Comment savoir si je peux partir en carrière longue ?
Vous devez avoir commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans et justifier d’un nombre suffisant de trimestres cotisés. Le départ peut avoir lieu à 58, 60, 62 ou 63 ans selon votre âge de début d’activité et votre année de naissance. Des simulateurs en ligne (Info Retraite, Assurance retraite) permettent d’estimer votre âge de départ.
6. La retraite progressive est‑elle accessible à tous ?
Elle est accessible aux salariés et agents publics ayant au moins 150 trimestres et exerçant une activité à temps partiel entre 40 % et 80 % du temps complet. À partir du 1ᵉʳ septembre 2025, l’âge requis sera de 60 ans pour tous. Les travailleurs indépendants et professions libérales peuvent également en bénéficier sous certaines conditions.
7. Quelles sont les mesures pour les mères et les aidants ?
La surcote anticipée permet aux mères ayant la durée requise de bénéficier d’une majoration dès 63 ans. Les congés parentaux (AVPF) et l’assurance vieillesse des aidants (AVA) sont mieux valorisés, pouvant servir pour les carrières longues et le calcul du minimum contributif.
8. Existe‑t‑il une retraite minimale à 1 200 € ?
Non. La revalorisation du minimum contributif et la pension complémentaire peuvent augmenter la pension des carrières complètes à près de 1 100 € bruts pour une carrière au Smic, mais la promesse de 1 200 € est inexacte.
9. Qu’en est‑il des régimes spéciaux ?
Ils sont fermés aux nouveaux entrants à la RATP, à la Banque de France, dans les industries électriques et gazières, chez les clercs de notaire et au CESE. Les agents déjà en poste conservent leurs droits. Les régimes spéciaux de la fonction publique sont maintenus mais ajustés (recul de l’âge, durée de cotisation).
10. La réforme pourrait‑elle être abrogée ?
Une résolution symbolique d’abrogation a été votée le 5 juin 2025 par l’Assemblée nationale, mais elle n’a aucune portée juridique. Un retour à 62 ans n’est pas envisagé par le gouvernement, et d’éventuelles modifications dépendront des négociations avec les partenaires sociaux ou des résultats des prochaines élections.
Cette FAQ synthétise les questions les plus fréquentes, mais chaque situation est unique. N’hésitez pas à consulter les simulateurs en ligne et à solliciter un conseiller pour un calcul personnalisé.