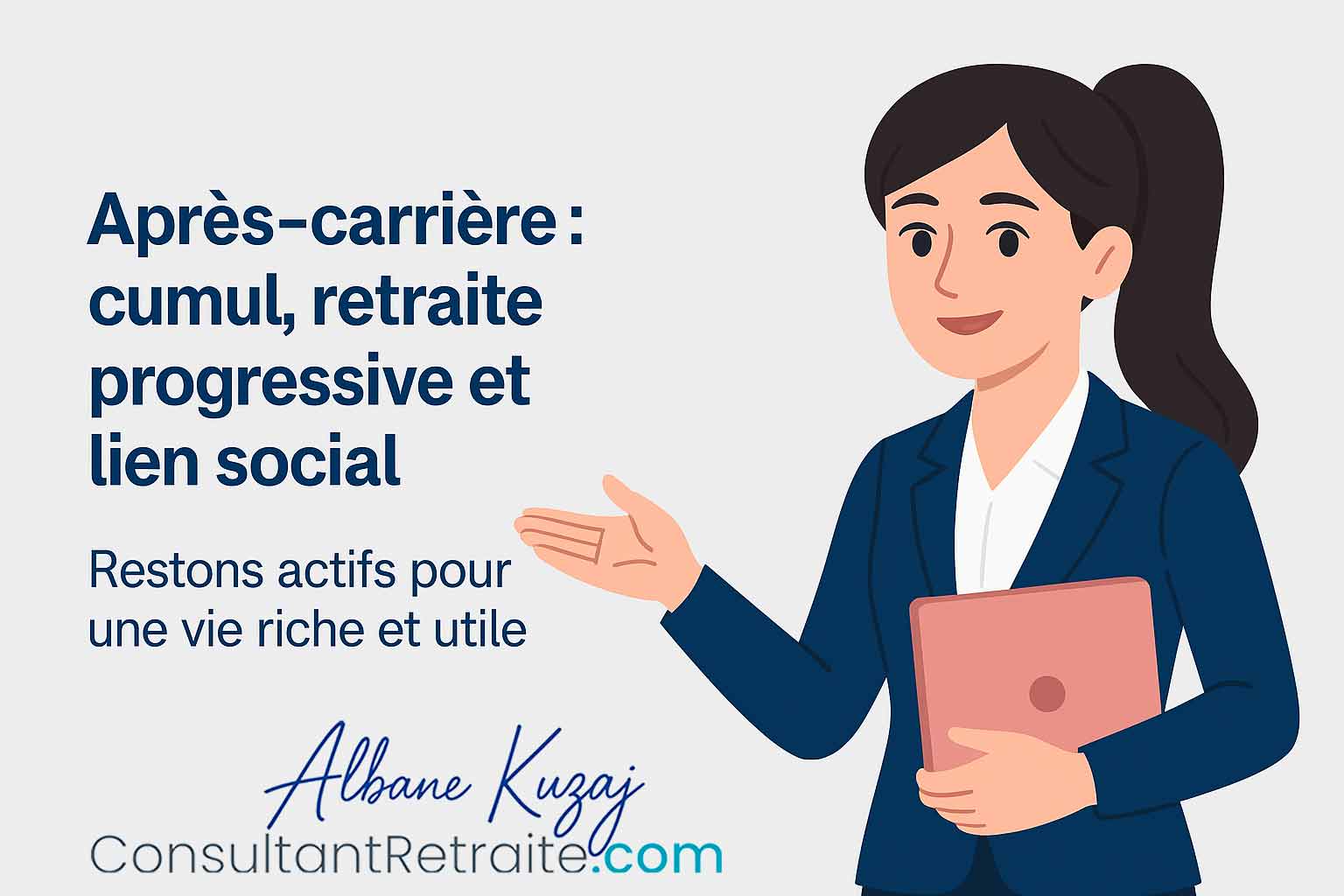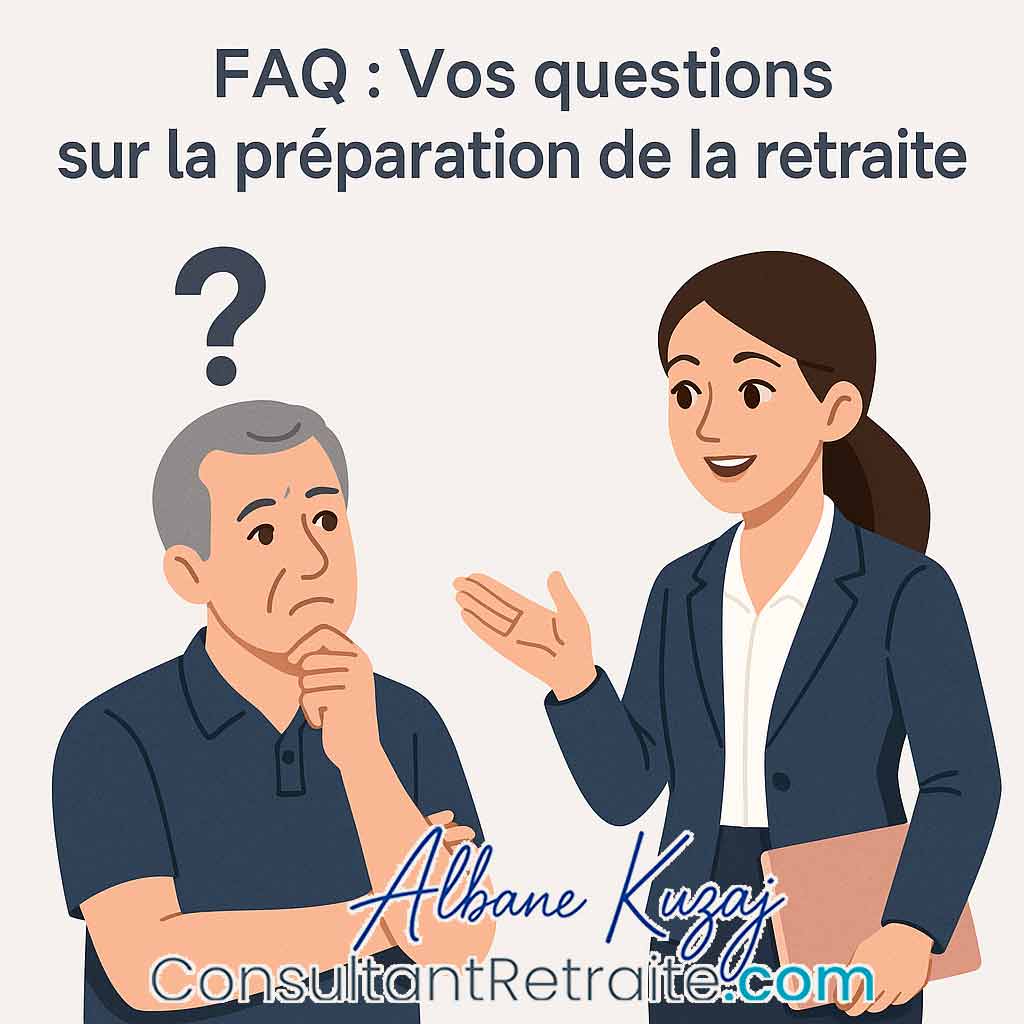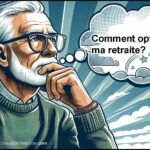5 conseils essentiels pour bien préparer sa retraite

Article mis à jour le 3 septembre, 2025
⚡ L’essentiel à retenir pour bien préparer sa retraite
Lecture rapide
Votre pension et votre qualité de vie sur 20–30 ans dépendent de quelques décisions clés. Voici les 5 points à ne pas manquer :
- Choisir la bonne date : viser le 1ᵉʳ janvier, la pension démarre toujours le 1ᵉʳ du mois.
- Évaluer sa pension : faire plusieurs simulations mais contrôler les données.
- Anticiper ses besoins : santé, logement, dépendance, organisation du quotidien.
- Vérifier son relevé de carrière : corriger trimestres ou salaires manquants.
- Penser à l’après-carrière : cumul emploi-retraite, retraite progressive, bénévolat, lien social.
Astuce : décaler son départ de quelques semaines peut valider un trimestre et améliorer le calcul de la pension.
La retraite est souvent présentée comme une étape naturelle : l’âge légal approche, on dépose sa demande et la pension arrive. Cette vision simplifiée masque pourtant une réalité beaucoup plus subtile. La France compte plusieurs régimes de base et complémentaires, des règles de calcul complexes et des délais administratifs qui peuvent varier en fonction des organismes. La qualité de votre pension et votre confort de vie pendant vingt ou trente ans dépendent de décisions à prendre avant de quitter la vie active.
Dans cet article de fond, nous proposons un guide complet et pratique à l’attention de celles et ceux qui vont bientôt franchir ce cap. Nous aborderons notamment les thèmes essentiels suivants : date de départ à la retraite, simulation du montant de pension, anticipation des besoins futurs (santé, logement, dépendance), vérification et correction du relevé de carrière, cumul emploi‑retraite et retraite progressive, lien social et activités post‑carrière. Notre objectif est d’expliquer en détail comment ces cinq décisions peuvent influencer la retraite d’un futur pensionné, tout en illustrant les pièges à éviter et les bonnes pratiques à adopter.
Nous nous appuyons sur des sources officielles (Service‑Public .fr, Assurance retraite, Ministère du Travail), des rapports publics récents, des études universitaires et des conseils de professionnels. Les faits, chiffres et recommandations cités dans cet article sont issus de ces sources fiables afin d’assurer une information juste et actualisée. En fin d’article, une foire aux questions (FAQ) répondra aux interrogations les plus fréquentes des futurs retraités.
1. Choisir la bonne date de départ : pourquoi chaque mois compte
Le premier conseil peut surprendre : partir au bon moment a un impact direct sur le montant de votre pension. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas seulement d’atteindre l’âge légal et de cumuler les trimestres nécessaires. En France, pour un salarié du régime général, la pension de base est calculée à partir du salaire annuel moyen des vingt‑cinq meilleures années. La dernière année travaillée peut faire ou non partie de ce calcul, selon la date de départ.
1.1 Comprendre la règle des vingt‑cinq meilleures années
Le régime général de la Sécurité sociale calcule le salaire annuel moyen (SAM) en faisant la moyenne des vingt‑cinq meilleurs salaires annuels revalorisés. Si votre dernier exercice contient des revenus élevés, il peut être intéressant de l’inclure dans cette moyenne. Toutefois, pour qu’une année soit prise en compte, elle doit correspondre à une année civile complète. En clair, l’année doit s’étendre du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre. Une année commencée ou terminée en cours d’exercice n’est pas forcément intégrée dans le calcul.
Exemple : vous terminez votre carrière en décembre 2025 et hésitez à partir le 15 juin 2025. Si l’année 2024 ou 2025 fait partie de vos meilleures années, partir le 1ᵉʳ janvier 2026 permettrait de retenir l’année 2025 dans le calcul du SAM. À l’inverse, un départ en cours d’année entraîne l’exclusion de cette année incomplète de la moyenne, ce qui peut faire retomber le salaire moyen à une année moins favorable. À raison de vingt‑cinq années sur l’ensemble de la carrière, quelques euros de différence sur le salaire moyen se répercutent durant toute la durée de la retraite.
1.2 Pourquoi la pension démarre toujours le 1ᵉʳ du mois
Une idée reçue consiste à croire qu’on peut partir le 15 ou le 30 du mois et toucher sa pension dès ce moment‑là. Le règlement est clair : la pension de retraite ne peut prendre effet que le 1ᵉʳ jour du mois qui suit votre demande. Si vous déposez votre dossier le 10 mai, votre pension ne commencera qu’à partir du 1ᵉʳ juin. Cela vaut pour tous les régimes du secteur privé ; certains régimes spéciaux appliquent des modalités comparables.
De nombreux candidats à la retraite rédigent leur lettre de départ sans prêter attention à cette règle. Résultat : ils partent en milieu de mois, perdent une quinzaine de jours de salaire et ne gagnent rien sur leur pension puisque celle‑ci démarre de toute manière le mois suivant. Planifier un départ le 30 juin n’a donc pas de sens en termes financiers. Privilégier un départ effectif le 31 décembre ou le 1ᵉʳ janvier assure que l’année civile sera prise en compte et évite une rupture de rémunération.
1.3 La question des trimestres validés
La pension à taux plein dépend non seulement de l’âge de départ mais aussi du nombre de trimestres validés. On valide un trimestre à partir d’un certain montant de salaire (1 570 € brut en 2025) et non en fonction de la durée de travail. Partir en cours de trimestre peut amputer votre carrière d’un trimestre validé si la rémunération du trimestre n’atteint pas le seuil requis. Les pensions calculées sans l’ensemble des trimestres nécessaires subissent une décote. Cette réduction appliquée au taux de calcul peut affecter la pension à vie. Décaler son départ d’un ou deux mois permet parfois de valider un trimestre supplémentaire et d’éviter la décote.
1.4 Stratégies de départ : anticiper les réformes
Les réformes successives modifient l’âge légal et la durée d’assurance requise. La loi de 2023 a repoussé progressivement l’âge de départ à taux plein et relevé la durée de cotisation. De nouvelles évolutions sont prévues pour 2025 et 2027. Pour décider de votre date de départ, prenez en compte :
- Votre année de naissance : le nombre de trimestres nécessaires varie selon les générations (167 trimestres pour les personnes nées entre 1958 et 1960, 172 trimestres pour celles nées à partir de 1965). La différence d’une année peut vous obliger à travailler plusieurs trimestres supplémentaires.
- Votre carrière : certains salariés bénéficient de dispositifs pour carrière longue ou pénible qui permettent un départ anticipé. Les travailleurs handicapés, les parents de trois enfants ou plus et les aidants peuvent également partir plus tôt. Il convient d’en vérifier les conditions.
- La comparaison salaire/pension : si vos revenus d’activité sont élevés, rester en poste quelques mois supplémentaires peut générer des cotisations qui augmenteront votre pension de base et votre pension complémentaire. Au contraire, si votre salaire a chuté ou si vous occupez un poste à mi‑temps, la pension versée peut être proche de votre revenu actuel.
1.5 Conseils pratiques et check‑list pour fixer sa date de départ
- Évaluez vos 25 meilleures années : consultez votre relevé de carrière et identifiez vos années les mieux rémunérées. Si l’année en cours fait partie des meilleures, un départ après le 1ᵉʳ janvier suivant permettra de l’inclure. Si ce n’est pas le cas, partir en décembre n’aura pas d’impact.
- Validez vos trimestres : assurez‑vous de disposer des trimestres nécessaires avant la date choisie. En cas de doute, effectuez un versement de régularisation ou rachetez des trimestres manquants.
- Prévoyez un délai administratif : déposez votre demande de retraite au moins quatre à six mois avant la date envisagée. Cela laisse le temps aux caisses de retraite de traiter votre dossier et d’ajuster les éventuelles erreurs.
- Coordonnez retraite de base et complémentaires : pour bénéficier du taux plein, vous devez liquider l’ensemble de vos retraites de base et complémentaires. Vérifiez les conditions spécifiques de votre régime complémentaire (Agirc‑Arrco pour les salariés du privé, IRCEC pour les artistes, etc.).
2. Évaluer le montant de sa pension : ne pas se fier aux apparences
Nombre de salariés font une confiance aveugle aux simulateurs de pension et se réveillent trop tard face à un montant bien inférieur à leurs attentes. La simulation est un outil indispensable mais elle doit être interprétée avec prudence, et certaines démarches complémentaires sont nécessaires pour s’assurer de la fiabilité des résultats.
2.1 Les simulateurs officiels : un service fiable mais indicatif
Le site Info‑Retraite (info‑retraite.fr) offre un simulateur qui agrège les données de vos régimes de base et complémentaires. Il permet de réaliser une estimation du montant de pension à différents âges et d’obtenir une projection de vos droits. L’administration précise que ce service calcule la pension à partir des données connues de vos caisses de retraite.
Cette simulation repose sur les informations enregistrées dans les bases des différents régimes. Or ces données peuvent être incomplètes ou erronées, comme nous le verrons plus loin en abordant la vérification du relevé de carrière. De plus, la simulation ne constitue pas un engagement de la caisse ; c’est un montant indicatif. Certains assurés ont signalé des écarts importants entre la simulation et la pension réelle, parfois jusqu’à 33 % de différence. Ces écarts s’expliquent par la mise à jour tardive des données, par des salaires ou des trimestres manquants et par l’évolution des règles de calcul.
2.2 Comprendre les paramètres du calcul
Le montant de la pension de base résulte de plusieurs paramètres :
- Le salaire moyen des 25 meilleures années (SAM) : comme expliqué plus haut, il s’agit de la moyenne des revenus bruts revalorisés. Les années antérieures sont revalorisées par un coefficient indexé sur les prix, ce qui atténue l’effet de l’inflation.
- Le taux de pension : en France, le taux plein est fixé à 50 % du SAM. Si vous n’avez pas le nombre de trimestres requis à l’âge légal, une décote diminue ce taux. La décote s’applique par trimestre manquant jusqu’à un maximum de 20 trimestres.. À l’inverse, si vous travaillez au‑delà de l’âge du taux plein et que vous dépassez la durée d’assurance requise, vous bénéficiez d’une surcote, qui augmente le taux de pension.
- Les majorations : des majorations de pension existent pour les parents d’au moins trois enfants, pour carrière longue, pour handicap ou pour pénibilité. Elles peuvent représenter plusieurs pourcents du montant final.
- Les régimes complémentaires : pour les salariés, l’Agirc‑Arrco convertit les salaires en points. Le montant de la retraite complémentaire correspond au nombre de points multiplié par la valeur du point en vigueur. Les points peuvent être plafonnés ou bonifiés selon les années. Les indépendants, artisans, commerçants et professions libérales ont leurs propres régimes complémentaires.
2.3 Simulation et réalité : pourquoi les écarts ?
La simulation est réalisée à partir des données disponibles. Or les caisses peuvent liquider la pension de manière provisoire, sans disposer de toutes les pièces justificatives. Le rapport de la Cour des comptes de 2025 a révélé que la liquidation provisoire est l’une des principales sources d’erreurs : de nombreuses pensions mal calculées demeurent définitives faute de régularisation. De plus, la mise à jour des données des régimes complémentaires n’est pas instantanée ; les trimestres validés lors de la dernière année de carrière apparaissent parfois avec plusieurs mois de retard.
Pour limiter les écarts entre simulation et réalité :
- Réalisez plusieurs simulations : effectuez des calculs à des dates et des hypothèses différentes (par exemple départ à 62 ans, 63 ans, 64 ans) et comparez les résultats.
- Vérifiez vos données : assurez‑vous que toutes vos années de carrière et vos salaires sont correctement enregistrés dans votre compte Info‑Retraite. Signalez les anomalies avant de demander votre retraite.
- Consultez un conseiller : les chiffres complexes et les règles multiples peuvent être difficiles à interpréter. Un rendez‑vous avec un conseiller retraite (CARSAT, Agirc‑Arrco, CIPAV…) permet d’obtenir des explications personnalisées.
- Gardez vos bulletins de salaire : ces documents servent de preuves en cas de contestation. En cas de décalage entre le simulateur et le calcul final, ils permettent de rectifier rapidement les erreurs.
2.4 Anticiper les évolutions législatives et les impacts fiscaux
Le montant de la pension est aussi influencé par la fiscalité et par les revalorisations annuelles. Les pensions de retraite sont soumises à la CSG, à la CRDS et, pour les plus élevées, à une contribution de solidarité. L’impôt sur le revenu s’applique à la retraite selon un barème progressif. Chaque année, le gouvernement peut décider d’une revalorisation des pensions en fonction de l’inflation. Toutefois, cette revalorisation peut être inférieure à l’inflation réelle, entraînant une perte de pouvoir d’achat.
Avant de partir, il est important de réaliser une projection du budget à la retraite : loyer ou remboursement de prêt, dépenses de santé, loisirs, voyages, impôts, etc. Cela permet de vérifier si la pension estimée couvrira les dépenses prévues et d’évaluer la nécessité d’un complément de revenus (épargne personnelle, investissement locatif, reprise d’activité…).
3. Anticiper ses besoins futurs : santé, logement, dépendance et organisation
La retraite marque un changement de rythme de vie. Les dépenses ne disparaissent pas ; elles se transforment. Penser à ces nouveaux besoins avant de quitter la vie active est la troisième clé pour une retraite réussie. Il s’agit d’anticiper l’évolution de sa santé, de son logement, d’éventuelles situations de dépendance et d’envisager l’organisation de son quotidien.
3.1 Préserver sa santé : prévention et modes de vie
L’espérance de vie augmente, mais vivre longtemps en bonne santé suppose d’entretenir son corps et son esprit. Les conseils issus de médecins et de spécialistes de la retraite soulignent l’importance de :
- Consulter régulièrement son médecin traitant : des bilans annuels permettent de détecter tôt des pathologies silencieuses (diabète, hypertension, cholestérol) et d’adapter son hygiène de vie en conséquence. La prévention comporte aussi des dépistages spécifiques (cancers, vaccins) adaptés à l’âge.
- Surveiller sa vue et son audition : les troubles sensoriels augmentent avec l’âge et entraînent isolement et perte d’autonomie. Un contrôle annuel chez l’ophtalmologiste et l’ORL, et l’adaptation de ses lunettes ou prothèses auditives, préviennent ces difficultés.
- Stimuler sa mémoire et entretenir ses relations sociales : pratiquer des activités intellectuelles (lecture, jeux de stratégie, musique), apprendre de nouvelles compétences et participer à des activités de groupe favorisent la plasticité cérébrale et ralentissent le déclin cognitif. La qualité du réseau social est un facteur clé de longévité et de bien‑être.
- Adopter une alimentation équilibrée : les nutritionnistes recommandent une alimentation variée riche en fruits et légumes, céréales complètes, protéines maigres (poisson, œufs, légumineuses), produits laitiers et une bonne hydratation. Limiter les produits transformés et le sucre contribue à prévenir maladies cardiovasculaires et diabète.
- Maintenir une activité physique régulière : marcher au moins trente minutes par jour, pratiquer un sport doux (natation, vélo, yoga) ou des exercices de renforcement musculaire et d’équilibre permet de prévenir la perte de mobilité, l’ostéoporose et les maladies chroniques. L’activité doit être adaptée aux capacités et débuter progressivement.
La santé mentale mérite aussi une attention particulière. La retraite peut provoquer un sentiment de perte de statut social ou d’utilité. Préparer des projets (voyages, formations, bénévolat, jardinage), maintenir des liens avec des amis et la famille et se fixer de nouveaux objectifs limitent ce risque. Lorsque les symptômes de dépression ou d’anxiété persistent, il est important de consulter un professionnel.
3.2 Adapter son logement : confort, sécurité et environnement
Plus on avance en âge, plus le logement doit être adapté pour prévenir les accidents domestiques et conserver son autonomie. Les conseils d’experts de la filière gérontologique et des organismes publics recommandent :
- Sécuriser sa maison : installer des barres d’appui dans la salle de bain et les toilettes, remplacer la baignoire par une douche à l’italienne, retirer les tapis glissants, améliorer l’éclairage, poser des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ces travaux réduisent le risque de chutes et sont souvent éligibles à des aides financières comme MaPrimeAdapt’.
- Prévoir la mobilité réduite : si votre domicile comporte des escaliers, envisagez l’installation d’un monte‑escalier ou d’un ascenseur, ou anticipez un déménagement dans un logement de plain‑pied. Dans les immeubles, vérifiez la présence d’un ascenseur et l’accès aux parties communes.
- Penser à l’environnement social : choisir un lieu de vie à proximité des services (médecins, commerces, transports), des proches et des activités favorise le maintien de l’autonomie et du lien social. La décision de rester dans sa maison ou de déménager dans une résidence services seniors ou un logement intergénérationnel doit être discutée avec ses proches et son médecin.
3.3 Préparer la dépendance : assurance et épargne spécifique
La dépendance est l’un des principaux risques financiers de la retraite. Une perte d’autonomie lourde peut coûter plusieurs milliers d’euros par mois (aide à domicile, établissement médicalisé, aménagement du logement). Selon un article spécialisé, les mesures nécessaires impliquent des dépenses importantes et il est recommandé de constituer une épargne ou de souscrire une assurance dépendance. Ces assurances, proposées par de nombreux assureurs, versent une rente ou un capital lorsque la dépendance est constatée et financent l’aménagement du logement ou l’hébergement en établissement.
Souscrire tôt (avant 60 ou 65 ans) permet de bénéficier de tarifs plus avantageux et de réduire le risque d’exclusion pour raison de santé. Les garanties varient selon les contrats (dépendance partielle ou totale, capital décès, services d’assistance) ; il est essentiel de les comparer en détail. Si vous ne souhaitez pas souscrire d’assurance, constituez une épargne dédiée (assurance‑vie, plan épargne retraite, compte à terme) pour couvrir d’éventuelles dépenses.
3.4 Organiser ses démarches et anticiper les imprévus
Outre la santé et le logement, de nombreux aspects pratiques méritent d’être anticipés :
- Succession et transmission : établir un testament, envisager une donation ou un mandat de protection future permet de protéger son conjoint et ses héritiers. Consulter un notaire clarifie les implications fiscales et juridiques.
- Assurances et couvertures : vérifier ses contrats (mutuelle, assurance habitation, responsabilité civile, assurance automobile) et ajuster les garanties aux nouvelles conditions (moins de déplacements professionnels, plus de loisirs).
- Rythme quotidien : planifier ses journées et ses activités pour éviter l’ennui. Se fixer des objectifs (apprendre une langue, effectuer du bénévolat, suivre des cours en ligne, voyager) structure le temps libre et prévient la désocialisation.
- Anticiper les coûts des soins longue durée : étudier les prestations de la sécurité sociale, les aides départementales (allocation personnalisée d’autonomie, aide sociale à l’hébergement) et les aides fiscales (crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile).
Anticiper ces besoins avant de quitter la vie active permet d’éviter les mauvaises surprises et d’adapter progressivement son mode de vie. Une planification financière et organisationnelle, avec l’aide d’un conseiller patrimonial si nécessaire, offre une vision d’ensemble sur l’après‑carrière.
4. Vérifier son relevé de carrière : un réflexe indispensable
Une erreur dans votre relevé de carrière peut réduire votre pension pendant des décennies. Les chiffres publiés par la Cour des comptes en 2025 sont sans appel : plus d’une pension sur dix attribuée en 2024 comportait une erreur financière. Les anomalies les plus fréquentes sont des trimestres manquants, des salaires non comptabilisés ou des majorations non appliquées. Ces irrégularités représentent un manque à gagner estimé à 900 millions d’euros pour les retraités.
4.1 Qu’est‑ce qu’un relevé de carrière ?
Le relevé de carrière (ou relevé de situation individuelle) est un document envoyé automatiquement tous les cinq ans à partir de 35 ans et disponible à tout moment sur votre compte Info‑Retraite. Il recense année par année :
- les salaires soumis à cotisations pour le régime général ;
- les périodes assimilées (maladie, chômage, maternité, service militaire, service civique) ;
- les trimestres validés et les points de retraite complémentaire ;
- les majorations pour enfants, carrière longue ou handicap ;
- les périodes travaillées à l’étranger.
Le relevé de carrière est la base sur laquelle les caisses calculent votre pension. Toute erreur non rectifiée avant la liquidation devient difficile à corriger par la suite. Or les erreurs sont fréquentes : par exemple, certains employeurs ne déclarent pas ou déclarent mal des périodes de travail, des périodes de chômage ou de maladie ne sont pas assimilées automatiquement, ou des points Agirc‑Arrco sont manquants. Les personnes ayant plusieurs employeurs, des carrières hachées ou ayant travaillé à l’étranger sont particulièrement exposées à ces oublis.
4.2 Comment repérer et corriger les anomalies
- Consultez régulièrement votre relevé : ne vous contentez pas de la période quinquennale. Connectez‑vous à votre compte sur info‑retraite.fr et téléchargez votre relevé au format PDF. Vérifiez que chaque année de travail figure et que les salaires bruts correspondent à vos bulletins de salaire.
- Vérifiez les trimestres manquants : comparez le nombre de trimestres validés avec la durée réelle de votre activité. Si vous constatez des trimestres manquants, notamment pour des périodes assimilées (maladie, maternité), prenez contact avec votre caisse (Carsat, MSA, SSI, CNAV) pour fournir les justificatifs nécessaires.
- Contrôlez la retraite complémentaire : assurez‑vous que les points Agirc‑Arrco correspondent à vos salaires. Pour les indépendants, vérifiez vos points auprès de la CIPAV ou du RSI. En cas de points manquants, adressez un courrier avec vos justificatifs (contrats de travail, attestations Pôle emploi, bulletins de salaire).
- Conservez et numérisez vos bulletins de salaire : ils constituent la preuve la plus solide en cas de litige. Les organismes peuvent exiger les originaux ou des copies. Il est recommandé de conserver les fiches de paie sans limite de durée, en version papier ou numérisée.
- Demandez une régularisation : si une erreur est identifiée, utilisez le service « Actualiser mon relevé » sur le site de l’Assurance retraite ou contactez votre caisse. Les démarches sont longues ; il est donc préférable de signaler les anomalies plusieurs années avant votre départ. Certains usagers ont rapporté des délais de traitement supérieurs à un an.
4.3 Pourquoi ces erreurs persistent ?
Le rapport de la Cour des comptes souligne plusieurs raisons : la complexité des règles, la liquidation provisoire sans vérification complète des pièces et l’absence de pilotage unifié des contrôles entre les caisses. Chaque Carsat applique ses propres procédures, d’où des écarts de qualité entre régions. Les fusions et les changements de système informatique ont également entraîné des pertes de données (par exemple, lors de la fusion Agirc‑Arrco en 2019). Enfin, les carrières internationales restent difficiles à retracer lorsque l’assuré n’a pas signalé ses périodes à l’étranger.
4.4 L’importance de la vigilance individuelle
Au vu de ces constats, la meilleure protection consiste à adopter une démarche proactive : ne pas attendre le départ à la retraite pour vérifier son relevé, contacter régulièrement les caisses, conserver ses documents et recourir à un conseiller indépendant si la situation est complexe. En cas d’erreur détectée après la liquidation, il est toujours possible de demander une régularisation, mais le processus est long et ne garantit pas la récupération de l’intégralité des sommes perdues. Il est donc essentiel d’agir en amont.
5. Penser à l’après‑carrière : cumul emploi‑retraite, retraite progressive et lien social
Le départ à la retraite ne signifie pas forcément l’arrêt complet de toute activité professionnelle ou sociale. Le cinquième conseil consiste à préparer l’après‑carrière en combinant plusieurs options : cumul emploi‑retraite, retraite progressive, bénévolat et maintenance du lien social. Ces dispositifs permettent d’augmenter ses revenus, de conserver un rythme de vie et de prévenir l’isolement.
5.1 Cumul emploi‑retraite : travail et pension
Le cumul emploi‑retraite (CER) permet à un retraité de reprendre ou de poursuivre une activité rémunérée tout en percevant sa pension. Ce dispositif est attractif lorsque la pension est insuffisante ou lorsque l’on souhaite maintenir une activité sociale. Les conditions varient selon que l’on a obtenu une pension à taux plein ou non.
5.1.1 Le cumul intégral
Vous pouvez cumuler intégralement votre pension de retraite et des revenus d’activité sans limite de revenus si vous remplissez les conditions suivantes :
- Vous avez liquidé toutes vos pensions de base et complémentaires (françaises et étrangères).
- Vous bénéficiez d’une pension de retraite de base à taux plein, soit parce que vous avez atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis (62 à 67 ans selon l’année de naissance), soit parce que vous avez atteint l’âge du taux plein automatique (67 ans ou plus). Certaines professions (artistiques, scientifiques, juridiques) sont exemptées de cette condition.
Lorsque ces critères sont réunis, vous pouvez reprendre une activité immédiatement après votre admission à la retraite, y compris chez votre ancien employeur. Les revenus d’activité s’ajoutent à la pension sans plafond et vous continuez à acquérir des droits à la retraite seulement depuis la réforme de 2023 (cumul intégral cotisant). Cela signifie qu’en travaillant après votre retraite, vous pouvez générer une seconde pension lorsque vous arrêterez définitivement.
5.1.2 Le cumul plafonné
Si vous n’avez pas validé votre pension à taux plein ou si vous n’avez pas liquidé toutes vos retraites, le cumul est plafonné. La somme de vos pensions (base et complémentaires) et de votre revenu d’activité ne doit pas dépasser :
- 160 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au 1ᵉʳ janvier (soit 2 882,88 € brut en 2024) ;
- ou votre dernier salaire brut avant la retraite. Pour les artisans et commerçants, le plafond est fixé à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS, soit 23 550 € en 2025), voire 100 % du PASS (47 100 €) dans les zones rurales ou quartiers prioritaires. Pour les professions libérales réglementées, le plafond est fixé à 100 % du PASS.
En cas de dépassement, la pension est réduite du montant excédentaire. De plus, l’ancien salarié souhaitant retravailler pour son dernier employeur doit attendre six mois avant de signer un nouveau contrat sous peine de suspension de sa pension. Le cumul plafonné ne permet pas d’acquérir de nouveaux droits à la retraite (pas de seconde pension).
5.1.3 Avantages et limites
Le CER représente une solution pour augmenter ses revenus tout en restant actif. Il peut être intéressant pour :
- compenser une pension modeste : en effectuant quelques heures de travail par semaine, on améliore son pouvoir d’achat tout en préservant ses droits à la retraite existante ;
- garder un pied dans la vie professionnelle : certains retraités craignent un isolement soudain. Continuer à travailler leur permet de maintenir des liens sociaux et de transmettre leur savoir‑faire ;
- tester une nouvelle activité : création d’une micro‑entreprise, activité libérale occasionnelle, prestations de consultant, travaux artistiques.
Toutefois, il convient de prendre en compte :
- la fiscalité : les revenus tirés du CER sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales (CSG, CRDS). L’ajout d’un revenu peut vous faire changer de tranche d’imposition.
- la récupération des aides : certaines aides sociales (allocation de solidarité aux personnes âgées, prestation complémentaire) sont conditionnées par un plafond de ressources. Le CER peut entraîner la diminution ou la suppression de ces aides.
- la santé et l’énergie : reprendre une activité demande de l’énergie et du temps. Il faut veiller à ne pas nuire à sa santé et à son bien‑être.
5.2 Retraite progressive : transition douce vers la fin de carrière
La retraite progressive permet à un actif de réduire son activité tout en percevant une fraction de sa pension. Ce dispositif favorise une transition souple et s’applique à partir de 60 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2025. Il nécessite d’avoir au moins 150 trimestres validés tous régimes confondus et de travailler entre 40 % et 80 % d’un temps plein. La pension versée compense la diminution de salaire.
Contrairement au cumul emploi‑retraite plafonné, la retraite progressive vous permet d’acquérir de nouveaux droits. Les trimestres cotisés pendant la retraite progressive s’ajoutent au compteur et augmentent la pension lors de la liquidation définitive. Pour demander ce dispositif, il faut obtenir l’accord de son employeur (pour les salariés) ou réduire ses revenus (pour les indépendants). La demande doit être envoyée à la caisse de retraite au moins cinq mois avant la date de départ, accompagnée des justificatifs (contrat de travail à temps partiel ou déclaration de revenus réduits). Le retraité peut mettre fin à la retraite progressive pour liquider sa pension complète ou basculer vers un cumul emploi‑retraite.
5.3 Bénévolat, clubs et activités collectives
Une fois à la retraite, toutes les ressources ne sont pas nécessairement financières. S’engager dans une association, rejoindre un club ou participer à des activités collectives apporte un sentiment d’utilité, renforce la santé mentale et crée un réseau social. Les psychologues et les sociologues soulignent que la qualité de la vie à la retraite dépend beaucoup du lien social. La célèbre Harvard Study of Adult Development – l’une des plus longues études sur le bonheur – a démontré que les relations humaines jouent un rôle majeur dans la santé et le bien‑être. Des contacts réguliers avec la famille, les amis ou de nouveaux cercles sociaux réduisent le risque de dépression, stimulent la cognition et prolongent l’espérance de vie.
Les retraités peuvent s’investir dans des activités variées :
- Bénévolat : associations caritatives, collectifs écologiques, aide scolaire, tutorat. Le bénévolat permet de se sentir utile et de partager ses compétences.
- Clubs sportifs et culturels : rejoindre un club de randonnée, de danse, un orchestre ou une troupe de théâtre favorise les rencontres et l’entretien physique.
- Formations et universités du temps libre : de nombreuses universités proposent des cours pour les seniors (histoire, langues, informatique). Ces formations stimulent la curiosité et facilitent les échanges.
- Voyages et découvertes : voyager seul ou en groupe, découvrir des régions ou des pays, s’inscrire à des voyages organisés pour seniors, etc.
L’après‑carrière n’est pas synonyme d’oisiveté ; il s’agit d’une nouvelle étape de vie qu’il convient de préparer avec autant de sérieux que le départ lui‑même. Choisir un équilibre entre activités rémunérées, bénévolat, loisirs et repos est la clé d’une retraite épanouie.
FAQ : Vos questions sur la préparation de la retraite
Quand faut‑il commencer à préparer sa retraite ?
Idéalement, il est recommandé de consulter son relevé de carrière dès l’âge de 45 ans et d’effectuer une simulation de pension une dizaine d’années avant la date prévue de départ. Cela laisse le temps de racheter des trimestres, de corriger les anomalies et de constituer un complément d’épargne si nécessaire.
Comment savoir si l’on atteint le nombre de trimestres requis ?
Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein dépend de l’année de naissance. Par exemple, les personnes nées entre 1958 et 1960 doivent valider 167 trimestres, celles nées en 1965 doivent en valider 169, et ainsi de suite. Le relevé de carrière indique le nombre de trimestres validés.
Peut‑on racheter des trimestres manquants ?
Oui. Le rachat de trimestres est possible pour les années d’études supérieures ou les années incomplètes. Le coût du rachat dépend de l’âge et du niveau de revenus. Cette opération peut être déduite du revenu imposable (dans certains cas) et permet d’augmenter le taux de pension ou le salaire annuel moyen.
Que faire si mon relevé de carrière comporte des erreurs ?
Contactez rapidement votre caisse de retraite et fournissez les justificatifs (bulletins de salaire, attestations). Les anomalies peuvent être corrigées jusqu’à l’âge de 60 ans. N’attendez pas la liquidation pour faire rectifier votre dossier.
Le cumul emploi‑retraite est‑il toujours avantageux ?
Le cumul est avantageux si vous bénéficiez d’une pension à taux plein et souhaitez augmenter vos revenus. Cependant, il faut veiller à ne pas dépasser les plafonds si vous ne remplissez pas les conditions du cumul intégral. Les impacts fiscaux et sociaux doivent être étudiés au cas par cas.
La retraite progressive est‑elle compatible avec le cumul emploi‑retraite ?
Ces deux dispositifs sont distincts : la retraite progressive s’applique avant la liquidation définitive et permet de cotiser pour de nouveaux droits, tandis que le cumul emploi‑retraite intervient après la liquidation. Il est possible de basculer d’une retraite progressive à un cumul intégral ou plafonné en fonction des conditions remplies.
Faut‑il souscrire à une assurance dépendance ?
L’assurance dépendance couvre une perte d’autonomie partielle ou totale et finance l’aide à domicile ou l’hébergement en établissement. Souscrire tôt permet de bénéficier de cotisations plus faibles. Vous pouvez également constituer une épargne spécifique pour faire face à ces dépenses.
Comment maintenir un lien social à la retraite ?
Le lien social se construit par les activités de groupe, le bénévolat, les clubs et l’éducation continue. L’étude de Harvard a démontré que la qualité de nos relations est le meilleur indicateur de notre santé et de notre bonheur.
En conclusion, la retraite ne s’improvise pas. Elle constitue un projet de vie à part entière, qui nécessite une préparation administrative, financière, matérielle et psychologique. En suivant les cinq conseils clés présentés dans cet article – choisir la bonne date de départ, évaluer précisément sa pension, anticiper ses besoins, vérifier son relevé de carrière et préparer son après‑carrière –, vous maximiserez vos chances de vivre une retraite épanouie, sereine et confortable.